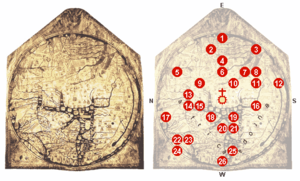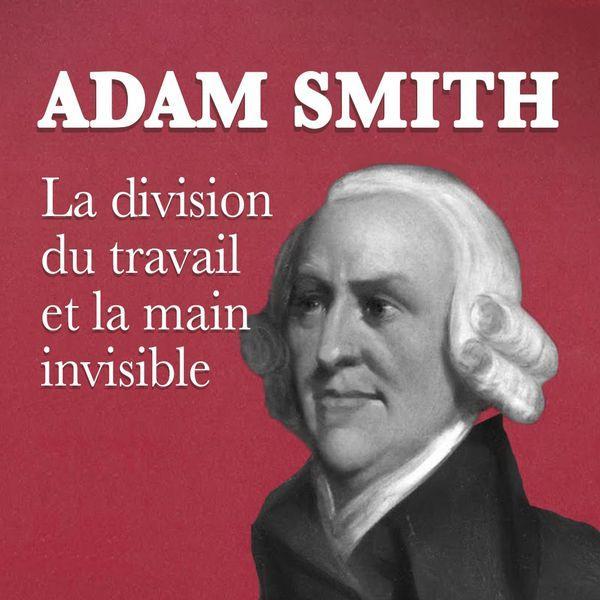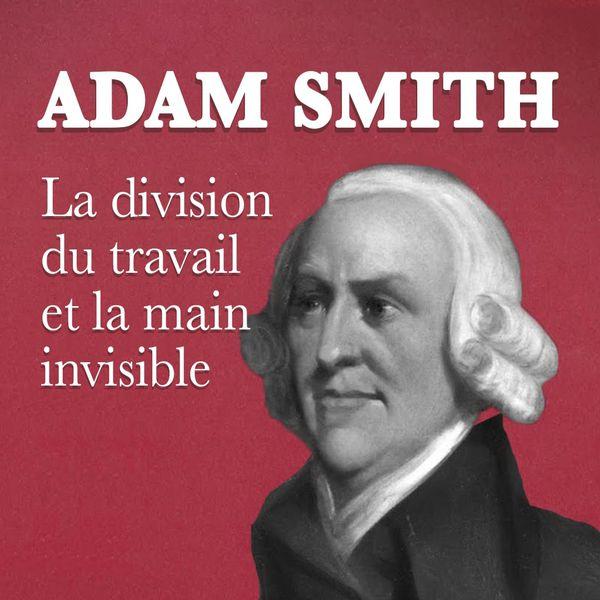Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 3
Je reviens sur une très bonne étude faite par le groupe indépendant ATTAC qui non seulement revient sur l'historique fondamental qui nous a mené à la situation économique actuelle de la planète entière, mais avait largement expliqué et anticipé les risques qui sont survenus depuis cet ouvrage qui date de 2004... Le groupe continue ses observations et interventions, et je suis personnellement assez en accord avec leurs conclusions, ainsi que l'historique :
II) suite
Liquidités et agrégats, un autre monde
La monnaie scripturale s'étant considérablement développée, on distingue maintenant les moyens de paiement courants, que tout le monde utilise au quotidien, et tout ce qui permet de constituer un capital financier, par exemple les actions d'une société cotée en Bourse ou un livret d'épargne. Ce qui a conduit à la définition des agrégats monétaires, liés à la liquidité, c'est-à-dire à la disponibilité des moyens de paiement.
L'agrégat le plus "liquide”, appelé M1, ou ensemble de la monnaie circulante, regroupe tous les moyens de paiement immédiatement disponibles, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire et les comptes à vue.
Le second agrégat, M2, est constitué de M1 auquel on ajoute tout le crédit à court terme, c'est-à-dire les sommes déposées sur des livrets ou sur des comptes à terme et disponibles en moins de deux ans. Une somme donnée peut passer d'un agrégat à l'autre, par exemple un dépôt de billets déposé au guichet pour être mis sur un livret passe de M1 à M2. Et si, étant dans M2, la banque le prête, elle le met sur un compte de dépôt et il repasse dans M1.
Pour former l'agrégat M3, on ajoute à M2 d'autres titres de créance et des titres du marché monétaire, qui sont de purs crédits.
L'endettement intérieur total regroupe tous les crédits, que ce soit sous forme de prêts bancaires ou d'émission de titres, et qu'il s'agisse de crédits aux entreprises, aux administrations publiques ou aux particuliers.
Quelques chiffres font comprendre que la monnaie circulante, celle qu'on manipule tous les jours, et à laquelle on pense quand il s'agit de monnaie, n'est en réalité presque plus rien en comparaison de tous ces crédits dont dépend l'économie, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des moyens de paiements : en 1999, l'agrégat M1 était évalué, en France, à 358 milliards d'euros alors que l'endettement intérieur total était près de six fois plus grand, presque 2.100 milliards d'euros, … soit plus d'une fois et demie le produit intérieur brut du pays !
Les moyens de paiement qui servent aux transactions sur les marchés financiers sont donc d'un montant bien plus considérable que la seule monnaie circulante. D'autant que ces transactions portent sur toutes sortes de titres négociables, non seulement les obligations émises par des entreprises pour financer leurs investissements, et qui sont du crédit, mais aussi sur les actions qui sont des titres de propriété. Nous y reviendrons.
Il y a ainsi beaucoup plus d’argent qui est dû aux banques que celui qui est en circulation. Il est évident que la dette ne peut jamais être complètement remboursée : si tous ceux (particuliers, industriels, commerçants ou État) qui ont un crédit dans une banque décidaient de rembourser leur banque, non seulement tout l’argent disponible serait nécessaire et il n’y en aurait donc plus du tout en circulation, mais, en plus, cela serait loin de suffire, il en manquerait encore beaucoup plus. Or, comment rembourser quand on n’a pas l’argent nécessaire ? — En empruntant à une banque, à qui il faudra payer des intérêts, etc. C’est un cercle vicieux, une spirale ouverte vers l’infini.
Le système bancaire, un garde-fous ?
La Banque de France a été chargée d'apporter un certain sérieux à cette organisation.
Nous avons évoqué le fait qu'elle est l'Institut d'émission de la monnaie légale, c'est-à-dire que c'est elle qui commande la fabrication des pièces et des billets. C’est par paiements aux guichets des banques commerciales que ces “espèces” entrent en circulation : lorsque ces banques manquent de “cash” pour leurs clients, ou bien elles se procurent des “liquidités” déjà en circulation en “se refinançant” auprès d’institutions financières privées (le marché interbancaire), sinon elles s’adressent à la Banque centrale. Celle-ci joue alors pour elles le rôle de “prêteur en dernier recours” en leur fournissant de la monnaie centrale en échange de titres de créances qu'elles avaient “en pension” et qui sont dits alors “réescomptés”. La monnaie centrale ainsi créée en contre-partie de titres de créance est dite monnaie de crédit de premier niveau.
D’autre part c’est la Banque centrale qui tient des comptes courants de toutes les banques commerciales (qu'on dit secondaires pour les distinguer dans cette hiérarchie) y compris celui du Trésor public. Elle est donc “la banque des banques” dont elle exige qu'elles lui déposent des réserves obligatoires en monnaie fiduciaire, qu'elle porte sur leurs comptes et qu'elle inscrit à son passif. Ces réserves, dont le montant dépend de la taille de chaque banque, c'est-à-dire des crédits que cette banque émet, ont été, à l'origine, instituées pour obliger les banques à se garantir en cas de demandes massives de monnaie légale de la part de leurs clients.
Cette fonction est le moyen qui a été trouvé de permettre à la Banque centrale d'exercer une pression sur la création monétaire ex nihilo par les banques secondaires et autres institutions financières. Mais remarquons bien qu'il ne s'agit que d'une pression indirecte, la variation du taux de réserves ne permettant à la Banque centrale que d'encourager ou de freiner la création de monnaie par les banques commerciales.
Et y regardant de plus près, on découvre qu'il existe deux types de taux d'intérêts, suivant celui qui prête et celui qui emprunte.
Quand ce sont les clients qui prêtent aux banques (comptes courants, livrets d'épargne, plans d'épargne-logement), il s'agit de taux créditeurs. Pour attirer l'épargne populaire, ces taux sont garantis et souvent réglementés, mais ils sont peu élevés ou même nuls dans le cas des comptes courants traditionnels. La marge de manoeuvre des banques sur ces taux créditeurs est donc faible.
Mais quand au contraire ce sont les intermédiaires financiers qui ouvrent des crédits à leurs clients, ils leur appliquent des taux dits débiteurs, et bien que l'argent, dit-on, n'ait pas d'odeur, ces taux sont fixés cette fois “à la tête du client”, ils dépendent de la “qualité de l'emprunteur”, c'est-à-dire de ses capacités de paiement. En fait il existe un taux débiteur de référence, dit taux de base, qui est lié aux taux directeurs, ceux du refinancement des banques auprès de la Banque centrale. Ce taux de base est le même pour tous mais il ne correspond qu'à ce qui est demandé aux emprunteurs “de première catégorie”, ceux dont leur banque juge qu'ils “ont les reins solides”. Pour les autres clients, les banques appliquent une marge au-delà du taux de base, marge d'autant plus grande que le client est jugé moins sûr. Et en plus de ces taux d'intérêts débiteurs, les banques font en général payer à leurs clients des frais divers, frais de commission, frais de gestion de dossiers, etc., qui sont rarement affichés, et qui peuvent beaucoup varier d'une banque à l'autre. Ces taux libres peuvent être très élevés; on dit simplement qu'un intermédiaire financier prend un taux “usuraire” quand, commissions comprises, il dépasse de 33 % du taux moyen tel qu'estimé par des enquêtes !
La démocratie confisquée
Jusqu'au début des années 1980, l'essentiel du financement de l'économie était ainsi assuré par des crédits octroyés par les banques et les institutions financières. Or celles-ci appartenaient en majeure partie au secteur public. En France, en 1984, les banques nationalisées
contrôlaient 87% des dépôts à vue et 76% des crédits distribués. C'est ce qu'on a appelé "l'économie d'endettement administré".
Ce régime, au cours des "Trente glorieuses", a permis de créer un environnement adapté aux besoins de l'économie en favorisant la croissance rapide des investissements productifs. Pouvant octroyer à certains secteurs des financements privilégiés, grâce à des prêts à taux bonifiés, inférieurs aux cours du marché, la politique avait un peu de pouvoir sur l'économie. Bien qu'abandonnée aux banques depuis longtemps, la création monétaire était, en majeure partie et de façon indirecte, régulée par la Banque centrale, qui assurait ainsi “l'encadrement du crédit”. Et l'État conservait, par cet intermédiaire, un "certain" contrôle sur l'activité financière du pays.
Et puis, patatras, en quelques années, tout ceci a été bouleversé, au nom d'une idéologie qui s'est imposée à toutes les économies dites “développées, les unes après les autres :
Au milieu des années 80, sous la pression des Think Tanks (20) inspirés des économistes tels que ceux de l'école de Chicago, dans le sillage du monétariste Milton Friedman, ou de Friedrich von Hayek, ce régime a fait place au régime "d'économie de marchés financiers libéralisés".
(20) Lire à ce sujet Les évangélistes du marché, par Keith Dixon.
Dès 1985 la part des crédits à taux administrés a été progressivement réduite.En 1987 c'est l'encadrement du crédit qui a été supprimé. Et en 1989 ce fut le tour du contrôle des changes.
Parallèlement, à partir de 1986, les banques nationalisées et les principales institutions financières ont été privatisées. (YH : historiquement, c'est bien la "gauche" qui a fait le travail que la "droite" n'avait pu faire avant avec le président Valery Giscard d'Estaing, bien que le mouvement ait été enclanché par les modifications de lois du président Pompidou...)
À la même époque a été créé le “marché unique des capitaux”, ce qui signifie que toutes les transactions, qu'elles soient au comptant, à court ou à long terme, sont maintenant accessibles à tous les agents économiques, qu'ils soient ou non financiers, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
Le grand, le super-, l’hyper-marché des capitaux
Cette création du marché “unique” des capitaux fût l’explosion d’un marché… multiple, qui consacra la mainmise de la finance sur l’économie, mainmise d’autant plus totale que même l’État fut soumis à ce marché par la loi de 1993 (voir ci-dessus “quand l’État est contraint d’emprunter au privé").
Énumérons, sans insister, ses multiples facettes.
Citons d’abord le marché interbancaire qui permet aux banques de s’arranger entre elles, les unes pouvant avoir des liquidités disponibles dont les autres ont besoin. Il revient à la Banque centrale d’en fixer ce qu’on appelle les taux directeurs : le taux “de refinancement du marché interbancaire”, qui y sert de référence, et les deux taux dits “de facilité”, les taux plafond et plancher entre lesquels les taux d’intérêt peuvent évoluer. En fait, ces taux varient au jour le jour, de sorte que ce n’est pas la politique monétaire qui les impose au marché interbancaire, mais la loi de l’offre et de la demande, c’est-à-dire la loi du marché.
Le marché dont le public entend le plus souvent parler est le marché financier, c’est-à-dire la Bourse. Deux sortes de titres (ou “valeurs mobilières”) s’y achètent et s’y vendent : les actions des entreprises “cotées” et les obligations.
Acheter des actions d’une entreprise c’est acheter une fraction de son capital. Cela comporte évidemment un risque : si l’entreprise prospère, sa cote, ou plutôt la cote de ses actions, monte et il est possible de réaliser une plus-value si on réussit à les vendre plus cher qu’on les a achetées. Il peut même arriver, si les bénéfices sont très élevés, que l’assemblée générale des actionnaires décide d’en verser une fraction (un dividende) à tous les actionnaires. Mais rien n’est garanti et l’entreprise peut voir ses actions baisser, par exemple si un bruit qui court permet de penser qu’elle rencontre des difficultés. En échange de ce risque qu’ils partagent ainsi, les actionnaires ont le droit de participer à l’élection du Conseil d’administration de l’entreprise qui en désigne le patron et est censé le contrôler. Mais tout ceci se passe en général entre “gros” actionnaires, initiés, et les petits ne font pas le poids (une exception récente fera date : les petits actionnaires d’Eurotunnel viennent de réussir à s’entendre pour changer la direction, dont le comportement s’était révélé vraiment catastrophique).
En achetant les obligations émises par une entreprise, il ne s’agit plus d’en devenir copropriétaire, mais de lui prêter de l’argent. En effet, quand une entreprise a besoin d’un crédit et qu’elle ne souhaite pas le demander à une banque, elle émet des obligations en s’engageant sur la durée et le taux d’intérêt de cet emprunt. Ainsi assuré d’une rémunération et d’un remboursement à date fixée, l’acheteur de ces titres de dettes prend beaucoup moins de risque qu’en achetant une action et il n’a, par conséquent, aucun droit d’intervention dans la politique interne de l’entreprise.
Les marchés financiers servent ainsi à pomper l’épargne vers les grandes entreprises. Et cette pompe marche si fort qu’en 2003 elle avait pompé dans le monde la bagatelle de 19.554 milliards de dollars (à comparer avec le PIB mondial qui était de l’ordre de 30.000 milliards).
L’explosion des marchés financiers s’est aussi manifestée par la naissance d’un nouveau commerce, celui des contrats qui se négocient sur le marché des produits dérivés et qui servent aux entreprises à se protéger contre toutes sortes de risques financiers, tels que la variation des taux d’intérêt, la fluctuation des cours des monnaies et même le pris des matières premières.
Pour tous ces “produits financiers”, on distingue le marché du neuf du marché de l’occasion. C’est sur le premier, dit aussi marché primaire, que les nouveaux titres mobiliers sont offerts au public, alors que sur le marché secondaire sont négociés les titres émis antérieurement et revendus (éventuellement par des spéculateurs professionnels).
Depuis 1991, le marché bousier national est aussi organisé en compartiments : il y a le premier marché, l’officiel, où les valeurs sont déterminées au jour le jour, le second marché, créé en 1983, destiné aux PME (petites et moyennes entreprises), le nouveau marché, ouvert en 1996, orienté vers le financement des “jeunes pousses” technologiques, et le marché hors-cote concernant les entreprises qui ne sont pas encore ou ne sont plus cotées au marché officiel.
Citons pour finir le marché hypothécaire, qui facilite le financement de l’immobilier en donnant aux établissements de crédit la possibilité de vendre leurs créances hypothécaires. Ce marché a donné lieu à une innovation aux Etats-Unis, appelée la titrisation des créances. En gros, disons qu’elle permet aux prêteurs (banques et autres organismes de crédit) de se refinancer en vendant leurs créances à des investisseurs non bancaires et donc de gérer plus sûrement les risques liés à ces prêts.
Le but affiché de toutes ces transformations, qui constituent ce qui s'appelle une révolution, était de faciliter la confrontation mondiale de toutes les offres et demandes de capitaux, sous quelque forme que ce soit. De ne plus réserver aux banques le choix d'investir pour qu'il soit désormais exercé par “la main invisible du marché” sous prétexte qu'un tel marché à l'échelle planétaire était la clé du développement et de la prospérité, que les pays pauvres allaient avoir ainsi accès à celle des pays riches. C'était la fin de la pauvreté…
Or la réalité est à l'opposé de ces promesses : ce sont les grandes entreprises des pays riches qui ont profité de ce type de développement, au détriment des populations pauvres. Parce que le fonctionnement de cette “main” est une fable, comme l'explique un témoin, J.E.Stiglitz, et on
peut lui faire confiance puisqu'il fut chargé de la politique du développement en tant que Vice-président de la Banque mondiale, en 1997-1999.
Voici ce qu'en dit cet expert, Professeur dans cinq universités prestigieuses (Yale, Oxford, Stanford, Princeton et Columbia) : «La fameuse “main
invisible”, régulatrice du marché ? Elle est invisible parce qu'elle n'existe pas. Le marché ne se régule pas de lui-même. La “théorie du ruissellement”, chère à Reagan, pour qui l'enrichissement des riches “ruisselle” toujours sur les pauvres ? C'est tout simplement faux.» (21)
La monnaie est devenue… capital (e)
En 1999, presque toutes les banques, en France comme dans tous les pays industrialisés, étaient revenues au secteur privé, et les marchés des capitaux avaient pris, dans le pilotage de l'économie, une part croissante par rapport aux financements bancaires. Qu’on se rassure, les banques n’y ont rien perdu, elles ont tout simplement élargi leurs activités pour participer autrement à l'économie mondiale, en y jouant un rôle supplémentaire grâce aux marchés financiers. Par exemple, qu’il s’agisse de la mise en vente de nouvelles actions lors d’une introduction en Bourse ou d’une augmentation de capital, ou d’une émission d’obligations, les sociétés sont obligées de passer par l’intermédiaire d’une banque, à qui elles doivent alors, bien entendu, verser une commission correspondante. Ce qui ne signifie pas que les banques ont renoncé pour autant à leur privilège d'ouvrir des crédits ex nihilo. En ce domaine, le taux de couverture (22), en leur fixant une limite, est en quelque sorte une bride sur leur cou. Les banques admettent que cette réserve obligatoire soit pour elles une garantie contre la faillite, mais si la bride est trop serrée, elles craignent de voir leurs clients investisseurs aller chercher ailleurs, c’est-à-dire sur les marchés financiers, leurs financements. On voit donc que les investissements, c’est-à-dire le dynamisme de l’économie, dépendent encore plus de ce taux depuis le grand tournant vers “l’économie de marchés financiers libéralisés”. De plus, les grandes banques américaines ont établi des systèmes d’évaluation de leurs risques, ce qui leur permet de déterminer elles-mêmes leur taux de réserve ce qui n’est évidemment pas sans conséquence sur la concurrence entre banques. Et c’est ainsi que l’ère du “ratio Cooke” (c = 0,8) vient de se terminer par un accord conclu à Bâle le 11 mai 2003 : le ratio “Bâle II” ne sera pas universel, il sera plus souple. Et s’il aidera, comme le dit un Professeur à Dauphine (ancien PDG de Paribas) “les meilleurs investissements” en faisant “payer les risques un à un”, il augmentera encore la marge de manoeuvre des géantes américaines. (YH : prouvé de nos jours (2014) : Goldman Saks et JP Morgan par exemple, même avec quelques déboires... tiennent le monde entre leurs mains !)
Même sans comprendre le sens et la portée de toutes ces réformes, le grand public peut constater dans les bulletins quotidiens d'information, et depuis plusieurs années, que les mouvements de la Bourse ont la vedette, et même en général avant ceux du football, ce qui n'est pas peu dire ! On voit qu'il s'agit d'inciter le commun des mortels à jouer son avenir à la Bourse, de le persuader que rien ne vaut le marché pour lui faire gagner la fortune dont il faut qu'il rêve.
Ces bouleversements financiers ont effectivement laissé aux capitaux la bride sur le cou et l'économie a ainsi été mise à leur service. Mais les bienfaits annoncés de cette manne se répandant sur les pays dits en voie de développement ne sont pas au rendez-vous. Les mouvements altermondialistes demandent un moratoire pendant lequel il serait possible de faire le point sur ces retombées. Ce moratoire est toujours refusé, et pendant ce temps, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) constate que 840 millions de personnes souffrent toujours de malnutrition, dans un monde qui n'a jamais tant produit… (en 2003). - 1 milliard en 2010...
Du crédit “à l'ancienne” au crédit “moderne”
Toutes ces transformations témoignent donc d'un changement radical dans les habitudes monétaires. Mais ce changement est insidieux parce que la grande majorité de la population continue à ne voir dans la monnaie qu'une valeur servant à acheter des biens économiques réels, et éventuellement une réserve pour différer ses achats. Effectivement, et nous y reviendrons, il n'y a plus d'échanges de marchandises, l'échange économique est devenu la vente-achat d'un bien ou d'un service contre de la monnaie, dont la nature est différente. Parmi ces transactions, les plus nombreuses, au quotidien, sont d'un montant relativement peu élevé, de sorte que le public ne voit de monnaie que la monnaie circulante. Il n'est pas conscient que la monnaie est devenue un symbole que les experts appellent la contrepartie du capital financier. Or ce symbole cache un pouvoir immense sur l'économie réelle, et il est un outil de décision utilisé pourtant de façon irrationnelle, car on sait bien que sur LE marché, devenu unique, la motivation rappelle plutôt celle
de joueurs au casino que celle de responsables de l'avenir du monde.
Sans que soient changés les mécanismes de la création monétaire, les attributions des banques ont donc été élargies, diversifiées et étendues à d'autres organismes financiers, également privés, et agissant magistralement sur l'économie en général, mais toujours avec pour seul objectif leur propre intérêt. Et le capitalisme a pu déployer son imagination, inventer de nouveaux marchés sur lesquels il est maintenant possible de faire fortune ou de se ruiner en vendant ou en achetant du risque, des options, etc. La spéculation est un art, réservé aux initiés, dont le menu peuple peut faire les frais, mais il ne peut pas le savoir.
Ainsi, pendant des millénaires, des Assyriens jusqu'à la Dame de Fer, soit, en gros, de 2.000 ans avant à 2.000 ans après J-C, le crédit a correspondu au délai entre le choix d'un achat et son paiement ; mais, comme l'exprime F. Rachline (23), «au départ comme à l'arrivée, indépendamment de la durée du crédit, une matière fait le poids», soulignant par ces termes le fait que les opérations bancaires sont toujours restées liées à des activités commerciales ou agricoles, qu'elles n'aboutissaient alors jamais à un commerce autonome, purement spéculatif, comme c'est le cas maintenant. Ce “crédit à l'ancienne” vient de faire place à un crédit pur qui «n'est fondé sur rien d'autre que sur lui-même», une avance comme une tête de pont qui serait lancée par-dessus un fleuve dont l'autre rive, si elle existe, est invisible.
Du franc à l'euro
Le principe de concurrence ayant été placé au coeur de la construction de la Communauté européenne, il était fatal que, dès sa création, l'euro soit placé sous un seul “contrôle”, celui du Marché. La création de l'euro n'a donc pas non plus changé l'essentiel du mode de création monétaire. Pire, le contrôle public tend un peu plus à disparaître. La Banque centrale européenne (BCE) décide maintenant du taux d'escompte de l'euro, mais elle n'est pas plus dirigée par des élus que ne l'était la Banque de France et il est moins possible que jamais de maîtriser l'évolution de la masse monétaire. Son Président est tenu à une complète indépendance vis-à-vis des gouvernements, il ne doit pas obéir à leurs directives, il n'a même pas à leur rendre compte.
Un seul objectif lui a été imposé par le traité de Maastricht : éviter que l'inflation dépasse environ 2% par an… pour ne pas pénaliser les investisseurs.
Tout se passe donc comme si les financiers, et les “économistes” à leur service, constituaient un monde à part, une espèce d'État international exerçant sa politique propre. Cet État a une organisation qui lui est propre et il gère ses affaires de façon autonome (24). En Europe, par exemple, son gouvernement est le directoire de la BCE, il établit ses lois financières, il a ses préfets, ce sont les banques centrales nationales, ses grands électeurs, ce sont les Ministres des finances des États, et ses administrés sont les opérateurs financiers.
Notons toutefois une nuance entre le rôle attribué à la BCE et celui de son homologue états-unien, la FED. En Europe, le traité de Maastricht impose respectivement et indépendamment à la BCE de veiller sur l'inflation et aux gouvernements de limiter leur déficit, quelles que soient les circonstances. Alors qu'aux États-Unis, les relations entre la FED et l'administration sont plus souples, c'est ce qui a permis au président G.W.Bush de diminuer les impôts tout en augmentant ses dépenses militaires pour atteindre le record de déficit déjà évoqué. Ainsi l'Europe copie sa révolution néolibérale sur les États-Unis, mais en y ajoutant une rigueur, sur ce point, qui entrave a priori sa compétitivité face à sa plus grande rivale !
«Votre argent m'intéresse !»
Ce développement sans précédent de la finance internationale a bouleversé l'économie mondiale. Alors qu'avant «la fonction du système financier international était d'assurer le financement du commerce mondial et des balances de paiement, les flux financiers internationaux ont connu une progression explosive, sans commune mesure avec les besoins de l'économie mondiale» (25). En 1998, par exemple, 1.600 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB annuel de la France, ont transité, chaque jour, par les marchés des changes. Ces opérations financières sont en moyenne 50 fois plus importantes que celles qui sont liées au commerce des biens et services.
La finance internationale a dérivé du financement de l'économie pour suivre maintenant sa propre logique, comme le dénonce René Passet : «Quand le banquier nous fait savoir, dans une publicité qui eut son heure de gloire, que notre argent "l'intéresse", c'est bien de notre argent qu'il s'agit, mais c'est lui qui en retire puissance et influence. On peut en dire autant de toutes les institutions qui concentrent nos moyens de paiement : banques et sociétés de courtage, fonds de pension gérant l'épargne par laquelle les salariés entendent financer leur future retraite, hedge funds ou fonds de performance, constitués à des fins purement spéculatives, mutual funds, fonctionnant comme nos SICAV. Ces institutions concentrent une "puissance de feu" redoutable, très supérieure à celle des états» (26). Les institutions financières (banques, assurances, fonds de placement et autres fonds de pension) n'ont pour objectif que la recherche du meilleur rendement, passant d'une monnaie à l'autre, d'euros en dollars, de dollars en yens, d'une action à l'autre, d'une obligation à une autre. Et c'est pour mettre ces mouvements financiers à l'abri des fiscalités nationales, protégeant ainsi la criminalité financière, qu'ont été créés les paradis fiscaux.
Anonymat de l'argent et secret bancaire permettent le blanchiment et le placement lucratif de l'argent, propre ou sale (celui de la drogue, des armes, des mafias, etc.), de sorte que les entreprises et les terroristes utilisent les mêmes moyens pour faire prospérer leurs finances.
La taxe proposée par le libéral Tobin pour remettre un peu de régulation ne pénaliserait que les transferts spéculatifs sur le marché des changes et non pas ceux qui sont nécessités par les échanges du commerce international, car les premiers se distinguent des seconds par leur fréquence : «Le long terme, dit un de ces spéculateurs, c'est pour moi dix minutes !»
Évolution du FMI : protéger les investisseurs, pas les populations.
En 1944 à Bretton Woods, quand fut créé le Fonds monétaire international (FMI) pour réguler le marché monétaire international, le droit des particuliers et des entreprises à investir leurscapitaux à l'étranger avait été limité par la plupart des pays, dont les États-Unis, pour éviter que la
spéculation nuise aux relations commerciales. Mais les gestionnaires de capitaux ont fait pression sur les gouvernements républicains soutenus par un électorat fortuné (Reagan, puis Bush), pour que soient levées de telles barrières. Après quoi c'est l'administration démocrate (Clinton) qui a saisi cette initiative républicaine pour financer ses campagnes électorales ; et la charte du FMI fut amendée… Elle est alors devenue, aux dires des plus modérés, le manager du système de crédit, ayant pour objectif, à court terme d'assister les créditeurs internationaux, et, à long terme, d'augmenter le rendement de leurs capitaux. Par contre, le FMI n'est pas concerné par la dette intérieure, par exemple celle du consommateur états-unien, qui en moyenne, à la fin de 2002, devait 40 % de son revenu.
Ceci nous amène au problème de la Dette du Tiers monde. En effet, que se passe-t-il quand l'économie d'un pays, en général du Tiers monde, est malade et que ses entreprises locales sont amenées à emprunter à l'étranger ? — Le FMI intervient car «en dehors d'un accord conditionné avec le FMI, il n'y a pas de prêt international possible» et il oblige les gouvernements des pays emprunteurs à prendre, sous le nom de "pactes d'ajustement structurel" (PAS) les mesures nécessaires pour assurer le plus vite possible le remboursement des créditeurs internationaux, c'est-à-dire pour maintenir le cours de la devise locale. Ces mesures, qui impliquent privatisations, austérité pour limiter les importations et faciliter les exportations, réduction des dépenses publiques et interruption des investissements productifs, ce qui entraîne une aggravation du chômage et la baisse de la production, donc des revenus, etc. forment ce qu'on appelle le consensus de Washington. Elles sont dans la logique du système de crédit, même si elles sont désastreuses pour les populations. Parce que le FMI n'a pas été conçu pour venir en aide aux habitants des pays en difficulté, mais pour éviter aux prêteurs internationaux d'être lésés, c'est-à-dire de ne pas être remboursés intégralement et avec intérêt.
Les investisseurs invoquent ce risque pour exiger des intérêts d'autant plus élevés qu'il paraît possible que le pays emprunteur ne soit pas en mesure de les rembourser. Mais le comble est que ce n'est pas eux qui assument ce risque, parce que si, malgré les PAS, un pays ne peut pas payer, c'est le FMI qui paie, et aux frais des contribuables !
(21) Joseph E. Stiglitz, dans Quand le capitalisme perd la tête, éd Fayard, 2003
(22) Voir ci-dessus “la création ex nihilo par les banques
(23) François Rachline, «Que l'argent soit. Capitalisme et alchimie de l'avenir».
(24) On trouvera des précisions sur l'organisation de la BCE dans l'ouvrage La Banque centrale européenne, par Francesco Papadia et Carlo Santini. Mais ce petit livre, publié par Banqueéditeur et rédigé par deux banquiers, le premier de la Banque centrale européenne, le second de la Banque d'Italie, est surtout une défense, sans la moindre critique, des directives données à la BCE par le traité de Maastricht. Pour l'analyse et la critique, lire L'euro sans l'Europe, manière de voir N°61, janvier-février 2002, éd le Monde diplomatique.
(25) D.Plihon, Le nouveau capitalisme.
(26) Dans René Passet, Eloge du mondialisme. Chapitre I, Les véritables maîtres du monde, pages 31-32.
Premières conclusions
À ce stade de notre étude, nous pouvons conclure qu'au moins deux idées fausses sont très répandues. D'abord on raisonne le plus souvent comme s'il existait une quantité d'argent fixée et qu'il faudrait “faire avec”. Alors qu’en fait, une telle contrainte ne s'exerce plus que sur l'État. Il semble également que beaucoup de gens soient persuadés que c'est le gouvernement d'un pays qui décide de la masse de sa monnaie en circulation, alors que ce sont au contraire des banques d'intérêt privé qui émettent la monnaie scripturale, qui en tirent profit et ont, en plus, le pouvoir de choisir les bénéficiaires de cette manne.
Nous avons compris que depuis qu'elle peut être créée très facilement, par de simples jeux d'écritures, la monnaie-symbole a perdu la garantie que constituait son lien avec une richesse matérialisée. L'évolution, d'abord progressive, insidieuse, mais qui s'est accélérée au cours des dernières décennies, fait qu'on constate aujourd'hui (écrit en 2003 et inchangé depuis...) :
• que la création monétaire échappe à toute décision politique, qu'elle n’a pas l'intérêt général pour objectif et qu'elle augmente les inégalités;
• que ce mode de création ne permet pas, par exemple, de financer une entreprise d'utilité publique mais non "rentable", parce qu'elle ne pourrait pas rembourser, ni, à plus forte raison, payer les intérêts liés à la création bancaire. On peut citer mille exemples de conséquences dramatiques de la nécessité de rentabilité de tout financement. Par exemple, la recherche fondamentale : il n'y a que l'État qui puisse financer une recherche scientifique fondamentale, qui ne débouche pas immédiatement ou même jamais, sur une application marchande et rentable. Dans le cas particulier de la médecine, des laboratoires pharmaceutiques privés, de plus en plus gros, financent la recherche de médicaments dits “porteurs”, attendus par une clientèle riche, et ils en exigent l'exclusivité du marché par des brevets ; par contre, la recherche concernant les maladies dites “orphelines”, parce que rares, est abandonnée, la clientèle potentielle n'étant pas suffisante pour attirer l'investissement ! On rencontre en permanence des situations analogues dans tous les domaines : une commune, ou une région, se trouve en face d'un besoin manifeste, par exemple la construction d'un pont, d'une crèche ou d'une route, pour lesquels existent les compétences, les architectes, les ouvriers disponibles, et tous les matériaux et les machines nécessaires. Ne manque que le crédit. La construction ne peut pas se faire parce que les besoins humains ne commandent pas la création monétaire et que les pouvoirs publics sont soumis à ces contraintes ;
• que ce mode de création monétaire ne pèse pas seulement de cette façon directe sur la société dans tous les domaines publics : il oblige toute entreprise qui a besoin de crédits à rembourser plus qu’elle n’a emprunté. Cette obligation oriente les choix des entreprises qui sont ainsi amenées soit à compenser cette augmentation de leurs coûts par des “économies” faites sur les conditions de travail ou à négliger “par économie” certaines précautions jugées trop coûteuses, soit à adapter leurs prix de vente pour pouvoir payer les intérêts de leurs emprunts, auquel cas ce sont les clients qui paient ces intérêts, et donc qui versent une rente au système bancaire.
Impossibilité de financer des entreprises non rentables, obligation de croissance des bénéfices, nécessité de réduire les coûts, ce mode de création monétaire pèse sur la société dans tous les domaines : santé, conditions de travail, environnement, connaissance, évolution, culture…
Ce qui devrait amener l'opinion à poser quelques questions :
• D'où vient ce choix du mode de création monétaire ?
— Nul débat politique n'est à son origine.
• A-t-il été spontané ?
— L'histoire a montré, en plusieurs circonstances (dont, en France, deux coups d'État napoléoniens) la pression exercée sur le pouvoir en place pour imposer les privilèges dont les banques jouissent encore.
• Ce choix est-il immuable ?
— Rien ne l'est, et surtout pas la monnaie, elle a changé tout au long de son histoire… (YH : et il y a même eu, il y a seulement 450 ans encore, des civilisations entières qui s'en passaient...)
Sources : http://www.france.attac.org/
A suivre pour la partie III
Yves Herbo, 04-10-2014